La semaine dernière, un article du New York Times – « Canada’s Policy on Immigrants Brings Backlog » – fustigeait le système d’immigration par point canadien. Disant qu’il empêchait justement le Canada d’atteindre un des objectifs de sa politique d’immigration : combler ses besoins en main-d’œuvre.
INSCRIVEZ-VOUS!

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.
Le principe de base : plus votre niveau d’employabilité est élevé, plus vous avez de points permettant d’atteindre le minimum exigé. L’employabilité est un coquetel composé du niveau de scolarité, l’expérience professionnelle, la maîtrise du français ou de l’anglais, l’âge, etc. Autrement dit, on considère que vos chances de trouver un emploi sont plus rapides et plus grandes si vous maîtrisez ou possédez le plus possible ces éléments jugés « gagnants ».
|
|
|
|
« Salman Kureishy dit que le Canada n’offre que peu de support aux immigrants » (traduction libre). Source : New York Times |
|
Sur quoi se base CIC ? Beaucoup sur la théorie du capital humain de l’économiste Gary Becker élaborée dans les années 60. Qui – en gros – dit que l’individu doit investir en lui-même (en formation, expérience, etc) s’il veut maximiser sa rémunération. Chacun doit se voir comme son propre capital dont il faut optimaliser le rendement. Qui s’instruit, s’enrichit.
C’est aussi l’idée que plus on est scolarisé/expérimenté, plus on développe des compétences plus informelles mais aussi précieuses : polyvalence, capacité d’adaptation, tolérance au changement, etc. Augmentant d’autant les chances d’emploi (comparativement à une personne fraîchement diplômée ou peu scolarisée). L’approche est intéressante en soi sur le papier. Surtout quand on vole allègrement vers tertiarisation et économie du savoir. Immigrants hautement qualifiés : venez-vous-en-icitte.
Mais la réalité est différente. On a tous une petite histoire d’horreur sur tel médecin maghrébin qui se retrouve chauffeur de taxi. Ou tel ingénieur africain qui fait de la plonge dans un restaurant. Ou la perte d’expertise de deux médecins belges. Autant de pointes d’iceberg cachant une réalité pancanadienne assez inquiétante.
Un moyen de vérifier si ce système de points fonctionne, serait d’observer le taux d’assimilation économique chez l’immigrant instruit. C’est-à-dire le temps nécessaire pour que (par exemple) Miguel, informaticien chilien, finisse par gagner le même revenu moyen que John, informaticien de souche. Bref, l’idée est que plus je suis instruit plus ce temps devrait être court.
Or, c’est pas exactement ça qu’on observe. En fait, aucune étude ne démontre clairement une corrélation positive entre niveau d’instruction et taux d’assimilation économique. C’est plutôt mitigé (voir les liens vers les études à la fin [1])
Ce qui est limpide par contre, c’est que malgré un niveau moyen de scolarité nettement supérieur à celui des natifs, la population active immigrante connaît un taux de chômage chroniquement plus élevé. Sans parler d’un niveau moyen de rémunération inférieur. Comme dirait Becker, il y a donc une sous-utilisation (comprenez : gaspillage) du capital humain de l’immigration.
Et le NY Times va plus loin en prenant l’exemple albertain. Sa formidable croissance économique explique en partie la difficulté des entreprises à y stabiliser leur bassin de main-d’œuvre. Mais une autre raison est aussi avancée : certains travailleurs étrangers – qui ont prouvé qu’ils répondaient à la demande – ne peuvent devenir résidents permanents … car ils n’obtiennent pas assez de points !
|
Fa que le système par point, y marche pas on dirait. En fait, il est symptomatique du « virage éducationnel » des gouvernements : jusqu’à encore peu, on favorisait la scolarisation à outrance. L’université, rien de moins mon fils. Pour réaliser que c’étaient surtout des métiers spécialisés qui allaient prendre leur retraite. Oups. Pas grave, on revire de bord et on change le message : vive les études professionnelles et techniques ! |
(source : toutpourreussir.com) |
Mais le mal était fait : on a eu une inflation généralisée des diplômes sans parler du pouvoir différent de chaque diplôme. Même chose chez l’immigration : une inflation d’universitaires en n’oubliant que le pouvoir attractif d’un technicien en génie civil était pas mal plus élevé que celui d’un docteur en littérature. Bien sûr, CIC et MICC se sont ajustés à ces changements mais avec la rapidité des mastodontes bureaucratiques qu’ils sont : lentement. En réalisant qu’environ 2/3 des emplois à combler seraient de niveau professionnel, le MICC a révisé sa grille d’admission en privilégiant davantage ce type de formation.
Le système par point est surtout révélateur de politiques d’immigration devenues lourdes, bureaucratiques et confuses. Et qui – surtout celle canadienne par son caractère uniforme – ne peut plus répondre aux besoins de plus en plus régionaux d’une économie canadienne coupée en deux (pour schématiser : les ressources naturelles de l’Ouest et le manufacturier de l’Est).
Que retenir de tout ça ? Qu’une approche purement économique – théorie du capital humain – de l’immigration est inefficace, par exemple. Ce qui sera cependant difficile à se l’admettre face à une économie canadienne très florissante et aux pénuries persistantes de main-d’œuvre. Il s’agira alors de se demander ce que l’on veut : un immigrant économiquement capable de produire ou culturellement capable de s’intégrer ?
On veut les deux en même temps (évidemment).
Hé bien avant que la crémière veuille bien nous donner cela, il faudra faire des compromis. Comme donner une chance à d’autres éléments plus difficiles à évaluer objectivement – contrairement au diplôme – mais tout aussi prometteurs (voire plus). Hicham Azeddioui, infirmier marocain qui travaillait depuis un an dans un hôpital montréalais – dont les collègues constatent la compétence et l’expertise – mais ne pourra pas y retourner car il a échoué à l’examen de l’OIIQ.
Maintenir cette politique généralisée du diplôme, c’est développer une culture du cheap labour chez l’immigrant. Mais attention, du cheap labour de luxe quand même. Un ingénieur civil de dix ans d’expérience qui fait un DEP en dessin du bâtiment. Une omnipraticienne qui s’inscrit en Technique en soins infirmiers. Un administrateur ayant géré quatre entreprises appliquant pour une job de préposé au guichet dans une banque.
Attention : ce n’est pas être du cheap labour que d’être dessinateur en bâtiment, infirmière ou préposé au guichet. C’est d’en être réduit à effectuer une tâche pour laquelle on possède une compétence bien trop élevée (que c’en est indécent) qui l’est.
Ici, on a largement dépassé le devoir d’humilité que l’immigrant doit avoir face au marché du travail local.
Ici, on a largement dépassé le réservoir d’optimisme en l’avenir et de confiance en soi que l’immigrant doit avoir face à son insertion professionnelle.
Ici, on a largement dépassé le seuil de normalité concernant l’adaptation et la tolérance au changement que l’immigrant doit gérer dans son projet d’intégration.
Ici, on a largement dépassé l’investissement dans la formation pour tomber dans le gaspillage de compétences.
Pourtant, on nous rabâche sans cesse que l’immigration est nécessaire, entre autre, pour le maintien de la croissance économique. Que l’immigration est une source d’enrichissement, que c’est un win-win.
Sauf qu’il semblerait que ça soit seulement l’économie canadienne qui en profite. Dans mon précédent billet, j’ai parlé de cette étude de StatCan montrant que l’immigration plus hautement qualifiée au pays avait pour effet de tendre les salaires vers le bas. En d’autres termes, au lieu que ça soit mon Miguel qui monte rejoindre John, c’est plutôt mon John qui descend rejoindre Miguel.
Probablement parce que les entreprises canadiennes et québécoises profitent justement d’une main-d’œuvre immigrante qualifiée qu’elles n’ont pas besoin pour l’instant et pour diverses raisons, de rémunérer à la juste valeur de sa compétence.
En ce sens, nous avons là des immigrants économiquement rentables pour le pays. Mais en avons-nous fait des immigrants culturellement intégrés ? Pas si sûr. Car la logique cheap labour favorise l’amertume et la méfiance de l’immigrant face à la société d’accueil. À ses yeux, il y a eu mensonge – pour ne pas dire trahison – dans ses chances d’emploi. Si encore cette logique était fondée sur un dédain des natifs pour les « sales » jobs mal payées, il y aurait une logique à en tirer. Un sens à donner aux interrogations. Mais ce n’est pas le cas : régulièrement, le marché du travail crie son besoin urgent de combler des jobs payantes et de qualité.
Au lieu du lien de confiance qui se crée, c’est un fossé d’incompréhension qui se creuse.
Car – et c’est mon credo – on a évacué l’enjeu culturel. Si deux capitaux humains se valent sur le papier, ce n’est pas le cas sur le terrain. Premièrement, parce que le pouvoir d’un diplôme est le résultat de plusieurs tensions structurelles sur lesquels personne n’a réellement de pouvoir (ex : un DEP en électricité gagnera plus qu’un bachelier en service social). Et deuxièmement parce que le marché du travail canadien – comme n’importe quel autre – accorde, toujours à capitaux humains équivalents sur le papier, une valeur supérieure à celui formé au Canada qu’à celui formé à l’extérieur.
Que faire dans ce cas-là ? D’abord, se trouver un bouc émissaire et se défouler sur lui. Ça fait du bien (ce qui est déjà pas mal). D’autant plus que les cibles faciles sont légions : les ordres, les délégations du Québec, le MICC, le réseau de la santé, les syndicats, le corporatisme. Mais vous savez comme moi que c’est un problème structurel : on l’oublie facilement mais une profession, c’est toute une job ! C’est toute une dynamique mettant en relation des intérêts divergents, des visions du monde ou des défis économique et démographique. Sans parler que c’est un problème loin d’être endémique aux immigrants.
Ce n’est que comme ça qu’on peut comprendre pourquoi un DEP en électricité gagne plus qu’un bachelier en service social. Sans oublier que l’immigration, ce n’est pas de la visite qui vient souper à la maison et qui s’en va après : l’immigrant veut rester (et souvent sur notre invitation). Ce qui fait qu’ouvrir les robinets en grand (assouplir les ordres, pousser sur la reconnaissance des acquis, etc) c’est un pensez-y bien.
Mr Ram Jakhu, professeur de droit à McGill et consultant en immigration propose d’accorder moins de points à l’expérience professionnelle (car elle n’est pas reconnue une fois ici) et plus de points à la maîtrise des deux langues officielles. Petit pas prudent, facile à encadrer, peu coûteux et qui aurait l’avantage d’enlever un peu d’hypocrisie au système.
Bon été à tous.
[1]
http://www.hrsdc.gc.ca/fr/sm/ps/rhdc/rpc/publications/recherche/2000-001263/page05.shtml
http://canada.metropolis.net/research-policy/wienfeldf/economie_f.html
http://www.statcan.ca/francais/research/11F0024MIF/pdf/abstracts/2005/II-C-Dhawan-Biswal.F.TR.pdf
http://www.publicpolicy.utoronto.ca/CLSRNconference07/papers/Mohsen.pdf




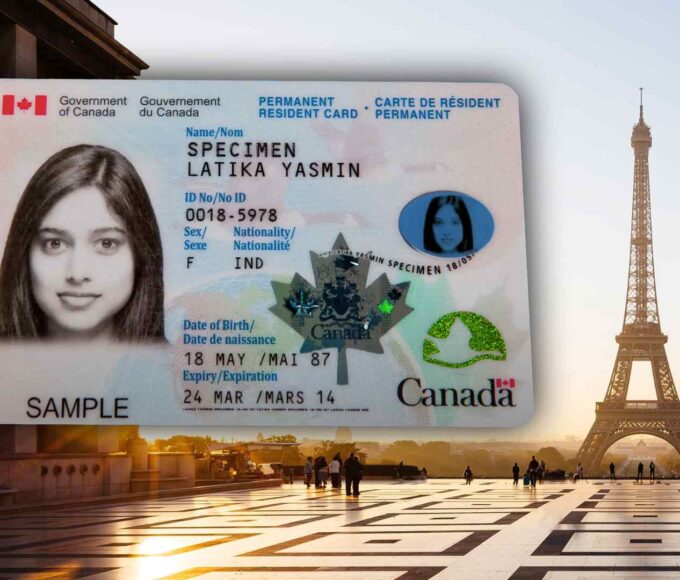


























Leave a comment