Intégration et Immigration
Si vous lisez régulièrement mes chroniques, vous n’êtes pas sans ignorer que je fais du multiculturalisme mon cheval de bataille préféré. Certainement parce que lorsqu’il est question de culture, on tombe dans le domaine pur du qualitatif et du subjectif. Bref, de quoi pelleter assez de nuages pour combler les longues soirées d’hiver.
INSCRIVEZ-VOUS!

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.
Selon Patrimoine Canada, « le multiculturalisme canadien découle, à la base, de notre conviction que tous les citoyens sont égaux. Il permet à tous les citoyens de conserver leur identité, d’être fiers de leurs ancêtres et d’éprouver un sentiment d’appartenance. L’acceptation donne aux Canadiens un sentiment de sécurité et de confiance en soi qui les rend plus ouverts aux diverses cultures et plus tolérants envers celles-ci. » Il semble donc que dans le « plusse » beau pays du monde, l’identité canadienne est donc en constante évolution, se construisant au fur et à mesure de ses flux annuels d’immigrants.
En fait, tout dépend de la définition que l’on donne au multiculturalisme. Prenons Montréal par exemple, tout simplement parce que c’est l’une des trois plus grandes villes canadiennes que je connais le mieux pour illustrer mon propos. Tout le monde s’entend pour dire que Montréal est une ville qui se distingue par son multiculturalisme : ses communautés culturelles, la diversité de ses commerces et le mélange savoureux des langues en tendant simplement l’oreille dans ses rues. Ainsi, au premier abord, il semble que le multiculturalisme version montréalaise fonctionne très bien en ce sens qu’il a réussi à créer un ensemble urbain harmonisant ses cultures québécoise, nord-américaine et étrangère. Le fait que Montréal soit une grande ville contribue également à son multiculturalisme : sa qualité de vie, ses musées, ses attractions touristiques, sa vie nocturne et, bien entendu, une concentration d’entreprises de plusieurs secteurs d’activités créant un important bassin d’emplois. Son pouvoir d’attraction est donc grand auprès des immigrants qui se constituent peu à peu en communautés, ces dernières devenant elles-mêmes des sources d’attraction pour les immigrants qui suivent. Avec le temps, c’est donc tout un mouvement qui se crée et, finalement, qui s’auto-entretient.
À cet effet, une enquête de Statistique Canada [1] semble confirmer ce constat : son objectif était d’étudier comment les immigrants parvenaient à s’adapter à leur nouvelle vie canadienne. On observe que le réseau social (parents et amis) a joué un rôle capital dans le processus initial d’établissement au pays. La majorité (78%) ont en effet choisi leur lieu de destination en fonction du lieu de résidence de leur réseau social : ce dernier constituait, bien avant les infrastructures publiques d’accueil, la première ressource face aux difficultés d’installation. Plus intéressant encore, les trois RMR (régions métropolitaines de recensement) que sont Vancouver, Toronto et Montréal ont été choisies par 44% des immigrants non pas pour leurs perspectives d’emploi mais surtout pour la présence de membres de la famille ou d’amis. Sachant que ces trois RMR accueillent à elles seules les trois quarts de l’immigration au pays, cela confère donc au réseau social un rôle très important dans l’adaptation des immigrants.
Une fois installés, ces mêmes immigrants ont constitué en très grande majorité (85%) leur nouveau réseau social (amis) parmi des personnes ayant les mêmes antécédents culturels. Plus précisément, 63% des immigrants interrogés ont déclaré que la totalité ou la majeure partie de leurs nouveaux amis appartenaient au même groupe ethnique qu’eux. Autrement dit, on observe une tendance marquée chez l’immigrant à rechercher à recréer en quelque sorte l’environnement social de son pays d’origine une fois installé ici. Dans un sens, c’est une attitude très compréhensible : même volontaire, une immigration représente un choc à plusieurs niveaux et il semble normal que la personne tente de compenser en essayant de retrouver des personnes ou des éléments qui lui sont familiers (et donc rassurants).
Avec le temps, se créent donc de véritables communautés culturelles définissant rapidement leurs propres règles de fonctionnement et s’incarnant progressivement dans un espace géographique (ce qui est presque inévitable dans la mesure où une culture, même minoritaire, n’acquière véritablement existence que dans un Lieu, ce dernier devenant ainsi l’expression de la reconnaissance sociale). Des communautés pouvant compter sur leurs membres pour se pérenniser durablement dans le temps soit par l’arrivage annuel de nouveaux immigrants économiques, soit par l’apport du parrainage de membres de familles (ce qui est l’intention de 47% des immigrants interrogés dans l’enquête).
Nous avons alors ici ces communautés culturelles qui font le bonheur du promeneur que je suis comme tant d’autres dans les rues montréalaises. Que ce soit des rêveries sur la rue St-Laurent, dans Chinatown ou dans la Petite Italie (pour ne citer que ces exemples). Forcément, la cohabitation de toutes ces communautés dans un espace aussi rapproché crée un certain brassage que ce soit au plan musical, gastronomique, linguistique ou artistique ; un brassage qui renforce le caractère multiculturel de la ville permettant de goûter aux saveurs du monde entier au même endroit.
Cependant, est-ce qu’il n’existerait pas un risque que ces communautés culturelles crée un certain phénomène de communautarisme ? C’est la question que s’est posé le journaliste Jean-Marc Léger du journal le Devoir dans un de ses articles [2]. Il soulève en effet l’inquiétude à peine implicite qu’une nation ne peut faire l’apologie d’un multiculturalisme prônant l’intégration et tolérer, dans le même temps, diverses manifestations d’un communautarisme qui retardent ou empêchent cette même intégration.
En effet, une concentration importante d’immigrants (quelques dizaines de milliers) en quelques quartiers bien précis suffirait à créer une certaine forme de communautarisme. C’est-à-dire une tendance à se replier sur soi aboutissant, inconsciemment ou non, à de véritables petits îlots presque hermétiques. Dans cet extrême, le pays d’immigration qui devait être la nouvelle patrie (ceci impliquant l’intégration à terme) n’est finalement qu’un lieu de résidence choisi surtout par pragmatisme : opportunités d’emplois, qualité de vie, présence de libertés individuelles et de pratiques démocratiques. Donc, il n’y a pas réellement d’interactions avec la société d’accueil : par interaction, j’entend un processus dynamique d’échanges entre les deux cultures (celle d’accueil et celle immigrante) où chacune apporte et concède à la fois pour opérer une intégration la plus achevée possible.
Par ailleurs, les progrès dans les technologies de la communication font en sorte que l’immigrant peut désormais, s’il le souhaite et qu’il en a les moyens, rester constamment en contact avec l’actualité de son pays d’origine par la radiodiffusion et la télévision par satellite. En d’autres termes, il peut quasiment travailler, vivre, manger et dormir sans avoir à transiger (ou si minimalement que cela reste insignifiant) avec la société d’accueil que ce soit sur un plan formel (institutions : carte d’assurance-maladie, numéro d’assurance sociale, etc) ou informel (5 à 7 avec des collègues de travail, goûter aux plats québécois, connaître le paysage artistique local, regarder les nouvelles télévisées). On comprendra donc qu’on est loin ici de l’immigrant « parfaitement » intégré. Ou, à tout le moins, de l’immigrant qui tente de l’être ….
Au-delà des motivations personnelles à chacun, cela se peut-il que le fait que Montréal soit justement une grande ville puisse contribuer au développement de ce phénomène de communautarisme ? J’y vais de manière purement probabiliste : se pourrait-il que plus la ville d’accueil soit grande, plus la possibilité soit forte qu’une communauté culturelle puisse y trouver un terrain favorable à son implantation (par le simple jeu de la taille) ? À l’extrême opposé, prenons un petit village (en Mauricie, Beauce ou en Estrie, nommez-les) constitué uniquement de québécois pure laine : l’immigrant qui y arrive n’aura pratiquement pas d’autre choix que de s’y intégrer, l’effet de taille ne jouant plus ici. Et forçant pratiquement de ce fait les interactions entre l’immigrant et les habitants du village. Cela ne supposant pas bien entendu une meilleure qualité des interactions, mais au moins interaction il y aura. Et ce premier pas est le prémisse obligatoire de toute intégration.
Est-ce à dire que toute intégration est impossible dans les grands ensembles urbains que sont Montréal, Toronto et Vancouver ? Et par conséquent que les villes moyennes situées en région (ex : Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville, Hull ou encore Saguenay) sont celles qui sont les mieux à même de permettre une meilleure intégration des immigrants ? Bien sûr que non pour ces deux questions. Il y a en effet tellement d’éléments rentrant en considération dans un processus d’intégration, dont beaucoup sont très subjectifs à chacun (définition personnelle de « qualité de vie », « nature », « mentalité des gens », etc). Mais il n’en reste pas moins que les grands centres urbains, d’ici ou d’ailleurs, offrent une masse critique suffisante de population pour qu’en émerge des communautés culturelles souvent bien identifiables (ex : Chinatown, Petite Italie). Des communautés pouvant constituer à l’extrême des villes à l’intérieur de la ville.
Un phénomène qui est beaucoup moins identifiable dans une moyenne ou petite ville, cette dernière n’offrant en effet suffisamment pas de masse critique pour qu’un immigrant puisse y trouver une communauté significativement autonome. Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas de communauté culturelle dans les villes de région : je crois cependant que leur développement s’effectue davantage de manière interactive avec la ville (et donc avec ses autres communautés). L’envers de la médaille est que plus un ensemble urbain est petit, plus les chances d’y retrouver une vie sociale et culturelle uniformisante sont grandes. Risquant de créer de ce fait une sorte de phénomène d’intégration standardisée où l’immigrant « bien intégré » est celui qui est capable de comprendre un épisode de la Petite Vie ou de voter inconditionnellement pour le PQ par exemple. Je vous l’avais dit : avec la culture, y’a de quoi combler vos longues soirées d’hiver en discussions interminables …. !
Multiculturalisme, communautarisme, le spectre de la ghettoïsation n’est jamais loin quand on aborde ces sujets. Surtout après les émeutes terribles qu’a connu la France dernièrement : tout le monde sait que les ghettos offrent un terreau favorable au racisme, à l’intégrisme et au clivages sociaux. Une étude sociologique de la répartition résidentielle des populations ethniques de la région montréalaise (de 1997 : elle commence à dater certes) semble montrer l’absence de ghettos à Montréal. « Ce n’est pas chacun dans son coin, explique Jean Renaud, auteur principal de la recherche. La vision commune veut qu’il y ait le quartier grec, le quartier portugais, et qu’on ne trouve que des Grecs dans le quartier grec. Nos données montrent que dans le quartier grec, on va aussi trouver des Syriens, des Libanais, etc. Donc, on ne peut pas parler de ghettos au sens strict. »
Mr Renaud continue en disant qu’il ne fait cependant pas de doute que certaines communautés se regroupent dans des quartiers particuliers. C’est le cas notamment des populations d’origines grecque, arménienne et juive (cette dernière étant d’ailleurs championne toutes catégories avec un « coefficient de ségrégation » de 85%). Observation plus intéressante encore : la variable ethnique n’explique pas seule les regroupements. L’histoire migratoire, le cycle de vie familiale et le statut socio-économique jouent tout autant : vivre à Westmount par exemple, c’est essentiellement une question de moyens et ce, indépendamment de l’ethnie. L’étude a identifié trois structures de voisinage ethnique typiques des différents quartiers montréalais : ethnique, religieuse et linguistique. En conclusion, s’il faut absolument trouver un ghetto, il faudrait considérer toute l’île de Montréal au complet ! Premièrement parce que dans plusieurs secteurs vivent des gens de plusieurs origines. En second lieu, si les communautés culturelles se concentrent surtout à Montréal, elles se répartissent pratiquement dans toute l’île. Nous sommes donc loin de l’image stéréotypée du ghetto …. à moins de voir Montréal comme un gigantesque ghetto multiethnique ! Même si les résultats de cette étude sont des réponses rassurantes face à tout raccourci pseudo-intellectuel associant communauté culturelle et violence urbaine, elles ne règlent pas pour autant entièrement la question de l’intégration. À savoir que même si ces communautés cohabitent harmonieusement à Montréal, peut-on réellement considérer la totalité de ces membres comme étant bien intégrés à la société québécoise sur les plans historique et culturel ?
Autrement dit, est-ce que la paix sociale régnant à Montréal (toute chose étant égale par ailleurs, nous conviendrons tous que nous sommes loin ici de la violence urbaine reliée à l’immigration qui prévaut dans plusieurs grandes villes) est signe d’intégration à la société d’accueil ? Dans un sens, oui. Intégration dans le sens que plusieurs ethnies sont capables de se côtoyer et d’interagir minimalement au sein de la société d’accueil dans le respect des lois et de l’ordre public. Dans un autre sens, on peut être un peu dubitatif. Une paix sociale entre immigrants et société d’accueil peut en effet signifier une indifférence réciproque qui, si elle ne blesse ou ne tue personne, peut cependant nuire à la construction d’une véritable société intégrée culturellement. Reste à savoir le pourquoi de cette indifférence si elle est avérée ….
La ville de Montréal n’est évidemment pas le Québec à elle toute seule, et personne n’avance cela. Pourtant, elle constitue à plusieurs égards un intéressant « laboratoire » de l’expérience d’adaptation des immigrants dont les apprentissages profitent grandement à toutes les villes québécoises. Pour être plus complet sur la question, une recherche comparative avec d’autres centres urbains d’importance (Laval, la ville de Québec) pourrait se révéler intéressante considérant les différences de densité, de géographique ou de mentalité. En conclusion, la question semble donc être : c’est quoi être intégré ? Difficile d’y répondre surtout que l’identité canadienne elle-même ne semble pas très bien se porter [4]. Les J.O. de Turin arrivent à point nommé pour peut-être raviver le tout !
[1] Enquête Longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC) – Statistique Canada (2003)
[2] « Deux obstacles majeurs à l’intégration » Jean-Marc Léger – Journal le Devoir du mardi 25 janvier 2005
[3] Renaud, J. et al., « Les grands voisinages ethniques dans la région de Montréal en 1991 : une nouvelle approche en écologie factorielle » Collection Études et cherches, no. 17, Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, mars 1997
[4] Sondage CROP sur l’identité canadienne – Magazine l’Actualité de février 2006





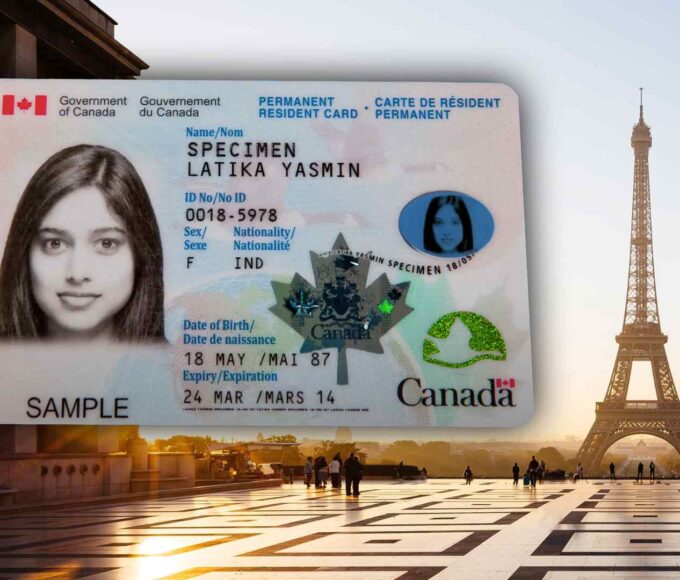























Leave a comment