Au Québec, actuellement et depuis plusieurs années, lorsqu’on parle d’interculturalité (et tout ce qui en dérive : communication interculturelle, échange interculturel, diversité culturelle, etc.), on pense généralement aux cultures différentes à la culture québécoise. Et de manière plus spécifique, aux cultures dont les immigrants sont porteurs. On peut ainsi constater tout autour de nous ce discours public – et faisant socialement consensus semble-t-il – soulignant et valorisant l’importance de la dimension interculturelle dans la société québécoise ; comprenez ici l’importance de l’immigration pour l’avenir (économique, démographique) du Québec. Il y a ainsi une sorte d’allant de soi que l’interculturalité est nécessairement reliée à l’immigration. Nous sommes d’ailleurs – au Québec comme partout en Occident de manière générale – demandeurs de cette interculturalité faite de gastronomie « exotique », de musique « ethnique », de culture « d’ailleurs ».
Or, le critère de culture différente à la culture québécoise doit-elle nécessairement être réservée qu’aux seules cultures immigrantes ? Dans le cadre de mon travail, j’ai récemment effectué une petite mise à jour de la littérature scientifique autour du thème de l’interculturalité : la majorité des résultats se concentrait sur l’immigration (enjeux, défis, insertion professionnelle, reconnaissance des diplômes, stratégies d’intervention, problématiques sociales, etc.). La majorité des livres que j’ai relevé traitant de l’interculturalité prend l’immigration comme population à l’étude. Décidant d’élargir un peu plus ma recension, je me mets à farfouiller des livres portant sur le management interculturel. Là aussi, sensiblement le même constat : les enjeux ici de l’interculturalité portent sur l’intégration, l’adaptation et la gestion de travailleurs immigrants en milieux de travail. Comme si à partir du moment où l’on parle d’interculturalité, on fait automatiquement référence à l’immigration. Comme si à partir du moment où je parle de diversité culturelle, je pense nécessairement à l’apport des cultures immigrantes.
INSCRIVEZ-VOUS!

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.
Dans un sens, je n’ai aucun problème avec ça. Il m’apparaît évident que l’immigration contribue fortement à pluraliser bien des pratiques sociales québécoises (ex : mélange des saveurs dans les plats cuisinés, intégration stimulante de styles musicaux, réflexions autour des manières de définir la vie en communauté, les relations de travail) et il est très bien qu’il en soit ainsi. Cependant, cela a tendance à réduire l’interculturalité à la seule dimension de l’immigration, ce qui n’est pas qu’une bonne chose en soi. Premièrement, que l’immigration (je fais référence ici au phénomène social et non aux immigrants eux-mêmes) monopolise pratiquement toute la définition de ce qui est publiquement entendu comme l’interculturalité occulte dès lors complètement les autres interculturalités, c’est-à-dire les autres groupes culturels existant également dans la société québécoise et qui, par certains traits, se différencient de la culture québécoise dominante. Ainsi, le cas des personnes sourdes est particulièrement intéressant à ce chapitre : cette communauté mène depuis des années une lutte incessante pour se faire reconnaître non pas tant comme groupe souffrant d’un handicap mais comme groupe possédant sa propre langue, véhicule linguistique d’une culture spécifique. Or, ce groupe n’est pas, me semble-t-il, perçu et reconnu comme groupe culturel avec qui il y a des échanges interculturels mais bien davantage comme groupe souffrant d’un handicap qu’il faut accompagner vers une normalisation sociale. Ici, la culture qui s’est élaborée autour de la surdité n’est pas synonyme de « diversité culturelle », « d’enrichissement » pour la société des entendants – comme cela est le cas avec les cultures immigrantes – mais de carence, de limitation, c’est-à-dire d’un manque qui ne peut avoir que si peu de richesses à offrir au reste de la société. Ceci dit, l’exemple des personnes sourdes est un choix facile : comme tout groupe porteur d’un « handicap » socialement reconnu, tout propos le concernant appelle souvent la compassion. Le cas des gang de rue ne devrait pas, à l’inverse, susciter de compassion. Pourtant, de par leurs normes, leurs rites, leurs valeurs et leur organisation sociale, ils peuvent constituer tout autant des groupes culturels – ou des sous-cultures si vous préférez – dans la mesure où ils se distinguent significativement des normes, rites, valeurs et organisation sociale dominantes dans la société québécoise. Sans aller jusqu’à leur accorder une légitimité sociale dans l’espace public, il me semble possible de ne pas les considérer uniquement comme groupe déviant et criminalisé. Ainsi, la personne membre d’un gang de rue n’est pas seulement une personne ayant plusieurs pratiques illégales mais c’est également une personne porteuse d’une culture, c’est-à-dire porteuse d’une représentation spécifique du monde qu’il est important de considérer et de comprendre pour l’aider dans son processus de réhabilitation.
Ces deux exemples ont pour objectif de montrer que la prédominance de l’immigration dans la représentation sociale que nous nous faisons de l’interculturalité « cache » d’autres communautés susceptibles de prétendre, elles aussi, au titre de groupes culturels (les privant dès lors des ressources institutionnelles leur permettant de changer les représentations que nous nous faisons d’elles). On pourra soulever l’exception notable des groupes autochtones : ces derniers apparaissent en effet comme l’autre groupe culturel reconnu, avec les immigrants, dans les ouvrages traitant d’interculturalité. On remarquera l’ironie de la chose : est classé dans la même catégorie que l’immigrant (constituant le groupe culturel le plus récent dans l’acception actuelle que nous nous faisons de l’immigration) le groupe culturel le plus ancien dans les espaces publics canadien et québécois, c’est-à-dire l’autochtonie !
Deuxièmement, le fait que l’interculturalité soit étroitement associée à l’immigration ne représente pas que des avantages pour l’immigrant. Bien entendu, le fait que ça soit un sujet à la mode, qu’on en parle beaucoup et régulièrement à la télévision, à la radio, dans les journaux et qu’on écrive à tour de bras des ouvrages sur la « diversité culturelle », les « échanges culturelles », la « communication interculturelle » pour nous apprendre à « parler avec cet Autre », à « découvrir ce migrant venu de si loin » contribue à rendre l’immigration beaucoup moins mystérieux. Toutefois, dans ce tourbillon médiatico-culturel, il serait très surprenant que l’immigrant maîtrise réellement ce qui est écrit, dit, partagé et véhiculé sur lui. Autrement dit, si l’on peut se féliciter que l’immigration constitue aujourd’hui un des enjeux incontournables du « Québec de demain », cela ne doit certainement pas nous décharger d’un important travail de vigilance. Rester attentif à ce qui se dit, se raconte, se partage et s’échange sur l’immigration. Car à partir du moment où l’immigration devient un « défi collectif » ou un « enjeu de société », chaque groupe, chaque communauté, chaque individu va donc s’en saisir pour donner sa propre opinion, va s’auto-proclamer expert en la matière avec toutes les dérives imaginables.
C’est ce qui pourrait s’appeler la rançon du succès : après avoir réussi le tour de force de faire de l’interculturel l’affaire de tous, on a donc fait de l’interculturel l’affaire de personne.




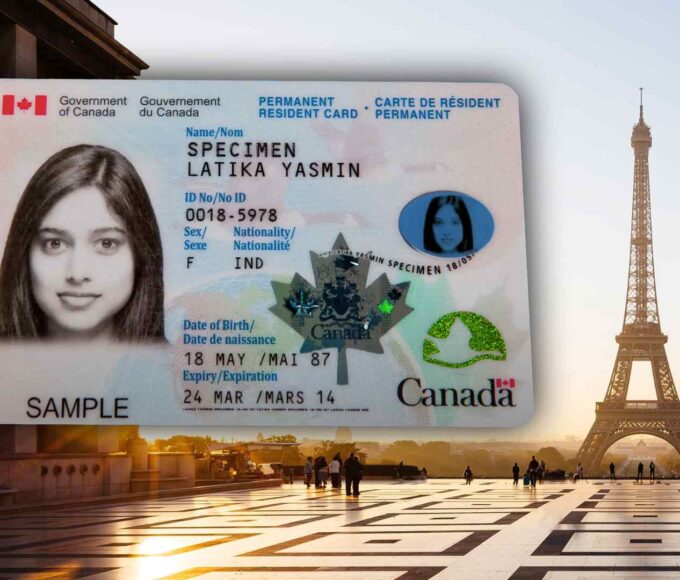
























Leave a comment