Premières Impressions
Cette année-là….
INSCRIVEZ-VOUS!

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.
1997. J’ai rencontré un Français qui est devenu mon amoureux. Petit problème : je vivais à Montréal. Un après-midi, ma chef, surexcitée, me convoque. « JayJay, alors, ton chum est reparti en France ? Comment ça s’est passé ?… ». Discrète, méfiante des raisons de cet interrogatoire, je réponds évasivement – mais je suis cramoisie de gêne, les yeux dans le camembert de ce trop-plein d’amour et de tristesse d’être séparée de mon homme pour qui sait combien de temps. Mes collègues de travail prennent plaisir à me dire que notre relation est vouée à l’échec, que je n’aurai jamais l’audace de traverser l’océan. Elles ne le diront pas longtemps. Lorsque je sortirai du bureau de ma chef, cet après-midi-là d’octobre 1997, c’est pour préparer mon départ vers Paris car je viens d’y être mutée.
C’est comme ça que commence l’aventure.
Quelques mois auparavant, j’étais dans un long couloir de monotonie et n’imaginais plus mon avenir. Je luttais avec désespoir contre une maladie endocrinienne chronique que l’on avait eu beaucoup de mal à identifier et encore plus de mal à traiter. J’avais abandonné mes études que j’aimais pourtant. Envolés, mes rêves de carrière, de voyages et de vie à l’étranger. Et pourtant….
À 20 h, en novembre, je débarque sur les Champs, où se trouve mon studio, et je suis avec l’homme de ma vie. Si vous passez devant le galerie commerciale du 78, ayez une pensée pour moi. C’était mon premier chez moi en France.
J’étais tellement pétrifiée par la circulation intense que je mettais 20 minutes à traverser les Champs. Combien de fois me suis-je perdue sur la Boétie, la Baume (où je travaillais), Haussmann…. Mes connaissances géographiques s’arrêtaient bêtement au quadrilatère. En six ans, j’ai appris à traverser les rues parisiennes en ne jetant qu’un coup d’œil à la circulation, au grand désespoir des étrangers qui m’accompagnent parfois.
Je connaissais Montréal comme le fond de ma poche, mais dans le métro parisien, je paniquais simplement à l’étude du plan, qui me paraissait impossible à maîtriser. Et pourtant je l’ai fait. Je vivais dans la peur d’oublier de composter mes tickets. J’oubliais de reprendre mon ticket de métro après l’avoir composté, et je paniquais parce que le tourniquet ne s’ouvrait pas. Peser mes légumes au marché n’était pas encore un automatisme.
Mon homme me faisait la cuisine pendant que je découvrais la télé française (et les pubs, surtout, que j’adorais). Je découvrais que Paris était magnifique mais très sale et surpeuplée. Découvrir les commerces, les accents, les gens, les odeurs…. c’était comme un film. Mais en même temps que je découvrais des sources d’émerveillement, certaines illusions tombaient.
Mon futur et moi cherchions un appartement. À la question : « Êtes-vous mariés ? », je répondais : « Non, pas encore, nous allons nous marier dans quelques m…. ». À deux reprises, on m’a raccroché au nez. Ou alors on ne me rappelait pas. Mon salaire était correct, mon employeur se portait caution, mais ça n’intéressait personne. C’est le statut de fonctionnaire (pourtant mal payé) de mon mari qui nous épargnera d’élire domicile sous le Pont Neuf.
Nous avons visité des appartements immondes. À Asnières, 4800 F par mois pour un taudis sale, mal fait, aux fils électriques apparents qui courent sur les murs, dans un quartier mal famé. Aux Buttes-Chaumont, 5200 F pour un appartement qui serait complètement à refaire, au-dessus d’un restaurant chinois (bienvenue les cafards). Je déchante en voyant les prix qui dépassent de loin mon budget mais plus je visite, plus je veux retourner chez moi. Je finis par trouver une merveille. Rez-de-chaussée, cour intérieure d’un petit immeuble bien tenu, dans le 92, très bien situé. Deux chambres…. et un beau jardin de 60 mètres carrés. 5600 F. Je le veux. Je n’ai pas d’économies, mais j’arrive à trouver les trois mois de caution nécessaires. Choc terrible, la caution et les frais d’agence. Chez moi, les propriétaires, à l’époque du moins, n’ont pas le droit de demander de caution, et il n’y a pas d’agence, donc pas de frais.
Au moment de la signature du bail, le responsable de l’agence me dit, un peu gêné, « Je ne crois pas que ce sera possible ». L’étude a été faite, nos salaires suffisent amplement…. Quel est le problème ? « Eh ben, voyez-vous, vous êtes Canadienne, et le propriétaire a peur que vous ne soyez mutée à nouveau. Il a peur que vous retourniez au Canada, il n’aime pas trop louer à des étrangers…. ». Je dois expliquer au propriétaire que je vais me marier à un Français, que je ne reviendrai pas au Canada, que ma famille est ici et que j’ai souhaité de mon propre gré venir vivre en France…. Et je signe enfin mon bail.
Mon employeur semble traîner pour la demande de permis de travail, donc je suis « illégale ». A bout de ressources, ne réussissant apparemment pas à comprendre qui que ce soit dans l’administration française, mon employeur me demande de faire les propres démarches pour l’obtention de permis. La Direction du Travail me raccroche systématiquement au nez en me disant que c’est mon employeur qui doit faire les démarches. J’ai beau leur expliquer que je suis la représentante de mon employeur, ils veulent apparemment parler à un conseil juridique, pas à une adjointe administrative. Je finis par obtenir les formulaires…. pour me rendre compte qu’il est quasi-impossible d’obtenir un permis de travail. Il faudra me faire passer au statut de cadre et justifier l’embauche d’un étranger. Mes chefs canadiens acceptent. Je rédige des pages et des pages de justifications. Mais un contact sérieux dans un cabinet de consultants concurrent au mien m’explique qu’ils ont eux-mêmes énormément de difficulté à muter des gens des Etats-Unis dans leur filiale française et qu’une demande de permis pour une directrice hautement qualifiée a récemment été refusée. Il m’avoue que je n’ai à peu près pas de chances. La seule solution, me dit-on, est de me marier.
Je suis dans une position particulière. Je suis la première employée de cette filiale française d’une compagnie canadienne. Malgré mon chum français, je suis loin de maîtriser toutes les subtilités des codes sociaux français, et je fais très sûrement des erreurs dont je suis à peu près inconsciente. Mais j’ai toute la bonne volonté du monde.
Ma première tâche au boulot consiste à acheter des ordinateurs, dont le mien. Mon chum m’accompagne à la Fnac. Bien que je sois l’acheteuse et que j’aie plusieurs questions à poser, le vendeur n’adressera la parole qu’à mon chum. Il faudra s’habituer. Dans les années qui suivront, lorsque je contacterai les hotlines pour les machines du parc informatique que je gère, on me demandera souvent de leur passer « le technicien ». Le technicien, c’est moi, en l’occurrence, mais ma voix est un peu trop haut perchée.
Et j’apprends que ma journée de travail, en France, débute en fait à 17 h 30. Bien sûr, je suis là dès 9 heures, mais vers 17 h 30, alors que je commence à envisager de me perdre dans ce 8è arrondissement que je ne maîtrise toujours pas, on m’apporte presque systématiquement une masse de travail, sans l’avoir annoncé. Fréquemment je passe des soirées devant mon portable, à essayer de comprendre le travail qui m’est demandé. Un soir, un des associés me remet à 17 h 55 une liste de fournitures à acheter pour le lendemain. Je cours chez le marchand et le supplie de garder son commerce ouvert quelques minutes pour que je puisse faire le plein. Je paye de ma poche puisque la compagnie, toute neuve, n’a pas encore d’historique de crédit. Toute fière de mon efficacité nord-américaine ( !), le lendemain matin, je le montre à l’associé qui me jette un regard méprisant en me disant qu’il n’en a plus besoin. Et là viendra un choc terrible : le milieu du travail est un véritable enfer. Certaines nuits, mes cauchemars seront moins pires que la réalité.
Je suis terrorisée, je veux être perçue comme étant proactive et efficace, n’ayant pas froid aux yeux. L’associé a besoin d’une réservation d’hôtel à Montréal ? Je réserve avec ma carte de crédit. Il me donne des dates pour réserver son billet d’avion, mais se trompe de dates. Il m’écrit un courriel un vendredi soir, disant que je me suis trompée, qu’il a dû payer des billets qu’il n’utilisera pas…. Excédée après des semaines de tyrannie, je lui réponds sèchement : « Vous voulez sans doute que je vous rembourse ? ». Il envoie ma réponse à tous les directeurs de la compagnie, en disant qu’il ne veut pas de cette Canadienne incompétente et mal élevée.
J’ai ma copine qui bosse chez Air France à Copenhague. Elle ne croit pas à cette histoire et me dirige vers un bureau d’Air France à Paris. Les dates supposément erronées ont été corrigées, l’associé a bien le bon vol. Il a fait tout ce cirque uniquement pour me faire sortir de mes gonds et pouvoir se plaindre aux directeurs. Bien sûr, tous les jours, des inconnus me « félicitent » pour mon accent. Mais je commence à comprendre que mes collègues détestent les Canadiens.
Encore touriste, je n’ai pas droit à une carte bleue alors je traîne sur moi mes 2000 francs qui serviront à payer comptant mes factures. Or, je me fais voler en plein centre commercial. Ma carte de crédit volée, l’organisme de crédit refuse de m’en envoyer une autre car je vis à l’étranger. Je porte plainte au commissariat. Pendant 30 minutes, les inspecteurs s’emploieront à me convaincre que j’ai égaré mon portefeuille, ou que je l’ai laissé dans mon appartement. J’ai beau leur expliquer que mon sac à dos a été ouvert sans que je ne m’en rende compte, qu’il m’apparaît évident que je ne l’avais pas laissé ouvert et qu’il l’a été dans un but précis, celui de me voler, que MasterCard m’a dit qu’il y avait eu plusieurs tentatives d’utiliser ma carte de crédit, ils insistent pour me dire que j’ai laissé mon portefeuille dans mon appartement. Je finis par me fâcher et une heure après, je sors enfin du commissariat avec un constat de vol, et avec une impression d’être la coupable.
La veille de mon mariage, une collègue française, dont les compétences se limitent à acheter des lampes à 20 000 F rue du Faubourg St-Honoré, me dit qu’ils ne sont pas sûrs de vouloir me garder. J’ai depuis un bon moment dépassé la période d’essai. Ils ont décidé de l’allonger sans m’en parler. Je suis effondrée. Je demande la permission de quitter à 16 h parce que je suis en état de choc et qu’après tout, je me marie le lendemain. Refusé. Je travaillerai jusqu’à 19 heures ce soir-là, à attendre un soi-disant travail qui ne viendra jamais.
J’ai quatre collègues français. Trois d’entre eux avouent bien haut leur haine des Canadiens, dont je suis. L’autre est trop bien élevé pour manifester sa haine ainsi. Fils d’un colonel, expert en stratégie, il finit par gentiment me faire comprendre de me détacher du clan canadien pour essayer d’entrer dans le clan français. Il me dit de ne plus communiquer les procédures venant du Canada, même si la maison-mère montréalaise me dit de le faire. Il m’explique que les Français sont foncièrement rebelles et que je ne ferai que m’attirer leurs foudres si je persiste à vouloir les domestiquer.
Et là, moi la diplômée de sciences politiques, j’apprends ce qu’est vraiment la politique. La magouille. La stratégie, la manigance. La perversité.
La femme d’un associé appelle. Il est en réunion, ma collègue prend le message – il faut la rappeler sur son portable. « Ah bon, et quel est son numéro de portable ? », demande-t-il sèchement. Ma collègue est interloquée : « Mais c’est votre femme, vous devez le savoir ? ». Il lève les yeux en l’air et lance « On voit que la Canadienne vous a coachée ».
L’associé en question est un colosse de 120 kg. Sale jusqu’au bout des doigts. Enceinte, il m’est arrivé de vomir le matin tellement son odeur était repoussante. Or il passe son temps à critiquer ma taille, mes vêtements, mes cheveux. Me tyranniser devant public est son loisir préféré, au point où il en gênera un de ses clients, un Directeur d’une société industrielle française très connue.
J’ai un autre collègue, dont l’antipathie pour les Canadiens est renommée. Ayant écouté les conseils de mon collègue stratégiste, maintenant identifiée au clan français plutôt qu’au clan canadien, j’essaie plus que jamais d’être proactive. Il doit changer d’ordinateur. Mon directeur montréalais est exaspéré par ses plaintes constantes concernant son matériel informatique (neuf). Il ne me donne aucune limite de budget. Je fais une analyse, et je lui choisis le nec plus ultra des portables, le plus cher. Si je me souviens bien, la facture était, à l’époque, de 45 000 FF TTC, du pur délire. Je lui annonce la commande par email. Il entre dans mon bureau en furie : « Comment cela se fait-il que je n’ai pas été consulté sur le choix de l’ordinateur ? ». Ma collègue, qui le connaît depuis plus longtemps que moi, tombe des nues. Elle lui explique mes efforts pour convaincre la direction. Il s’excuse vaguement et ressort de mon bureau. Ce charmant collègue fait partie des jeunesses chrétiennes et est supposément un fervent croyant pratiquant. Il a également l’honneur d’être dans le Top 5 des personnes les plus foncièrement méchantes que j’aie connues. Souvent, des Français me disent que nous les Québécois sommes très bien perçus en France. La majorité des Français côtoyés au cours de mes deux premières années étaient pourtant hostiles envers les Canadiens. Bien sûr, il s’agissait d’une guéguerre de pouvoir entre direction française et direction canadienne. Par-dessus tout, les associés et employés français ne supportaient pas de se faire dire quoi et comment faire par la direction canadienne. Mais hormis ces raisons « politiques », ils éprouvaient également un profond mépris envers les Canadiens. On disait en rigolant que les Jurassiens étaient une version plus civilisée des Québécois, notamment. Mes collègues se moquaient des fringues canadiennes, de notre manque d’étiquette à table, de notre manque de connaissances générales (de connaissances sur la France, devrais-je dire). Pendant deux ans, je les ai entendus nous casser du sucre sur le dos tous les jours.
J’ai passé mes deux premières années en France à me répéter la phrase nietzschéenne : « Ce qui ne nous détruit pas nous rend plus fort ».
Mon but ici n’est certainement pas d’engager une énième polémique sur les mérites et les travers de la France. C’est une description de mes deux premières années en pays étranger. Mes premières impressions. Deux ans de galères. Les gens qui ont été témoins de cette époque savent que ce que je vous raconte s’est véritablement passé et que je ne modifie pas la réalité juste histoire de remplir les pages blanches de ma chronique. Il s’agissait plutôt brièvement de quelques anecdotes, ayant cependant omis quelques détails trop personnels. C’est l’histoire du début de mon immigration. C’est ma réalité. Mais ce n’est pas la vôtre. Vous, Français, ne reconnaîtrez pas votre pays et vos compatriotes dans ce que je vous ai décrit.
Souvent, il arrive que je ne nous reconnaisse pas, Québécois, dans les critiques qui sont émises à notre égard par certains immigrants. J’ai, moi-même, plusieurs critiques envers mon pays. Mais souvent, j’ai le sentiment que les descriptions négatives du Québec ne correspondent pas à ma réalité. Je sais que certains d’entre vous tombez de haut, parfois. Bien sûr, la France n’ayant pas une politique d’immigration ouverte, on ne peut pas l’accuser d’avoir fait miroiter de belles promesses comme le MRCI le fait, selon certains. Mais je suis parfois un peu lasse d’entendre dire que les Québécois ne savent pas ce qu’est l’amitié sincère, que les jobs sont mal payés, que les Québécois ne sont pas si chaleureux que leur réputation le veut, que leur seule notion d’histoire s’arrête au match d’hier soir. Sur le cercle restreint de mes connaissances durant mes deux premières années, soit sur environ six ou huit Français que j’ai eu l’occasion de côtoyer et d’apprendre à connaître, j’ai rencontré quatre Français qui étaient de véritables goujats. Prétendant avoir de la culture, l’un fervent catholique, l’un gauchiste snob, l’une la quintessence de la bourgeoisie du 92 (j’en passe), tous grands voyageurs supposément ouverts aux autres cultures, je les ai entendus cracher sur tout ce qui n’était pas diplômé de l’ENA, résident du 92 (dont je faisais pourtant partie, ô ironie !), sur les étrangers, sur les gais, sur les Arabes, sur les Espagnols, et surtout, surtout, sur les Canadiens. Ce sont très certainement les êtres les plus abjects que j’aurai rencontrés dans ma vie. Et dire que j’ai failli en rester là et généraliser à toute la population….
Si j’avais basé ma décision de rester ou de revenir sur ma première année de vie en France, je ne serais certainement pas restée. Mon homme me retenait de gré ou de force ( !), je n’ai pas eu réellement le choix. Au bout d’un peu plus de deux ans, ma vie a changé, heureusement. Je suis, sincèrement, mal tombée ces deux premières années. Après un premier congé de maternité, j’ai changé d’emploi. Les conditions étaient nettement meilleures. Dans une entreprise où les Français côtoyaient les Américains, la mentalité était tout autre. Le management ne brillait pas toujours, mais j’étais relativement heureuse (quoique toujours très, très stressée au travail et croulant sous une charge de travail impossible).
Je suis fière d’y avoir vécu longtemps, et si certaines variables avaient été plus favorables, j’aurais continué d’y vivre. Si professionnellement je n’avais plus grand espoir, j’ai pourtant beaucoup appris – à la fois techniquement et « politiquement » ou humainement. J’ai eu droit aux formations, au 1% patronal, aux 35 heures, aux RTT, aux 5 semaines de vacances, aux intéressements…. Mieux encore, j’y ai connu des bandes de copains avec lesquels jamais je n’ai autant ri. J’ai bien peur que pour la plupart d’entre eux, ce n’ait été qu’une amitié provisoire et superficielle (un reproche habituellement adressé aux Québécois mais que j’ai parfois ressenti envers mes amis français). Tant pis, j’ai eu du fun quand même. Certains de ces copains ont fait une véritable différence dans ma vie.
La clé du succès, dans mon cas, a été d’oublier un peu mon identité canadienne et de devenir un peu plus « Française ».
Mais ce n’est pas arrivé dans mes tout premiers mois en France. Ce n’est même pas arrivé la première année. Ce fut un processus long dans lequel j’ai investi énormément, moi la froide et superficielle maudite Québécoise. J’ai bénéficié de l’expérience de ma cousine qui avait vécu tout ce processus avant moi. Elle vous le dirait comme je vous le dis aujourd’hui que notre vraie intégration a commencé le jour où nous avons eu notre propre famille. Pour moi, elle a commencé trois ans après mon arrivée avec ma première grossesse, lorsque j’ai eu ma première bande de copines, mes premières cyberlectrices qui se marraient de mes aventures de femme enceinte dans le métro ou engagée dans un combat épique avec la secrétaire du labo d’analyses médicales.
L’immigration, ce n’est pas rassembler les papiers et attendre le CSQ. L’immigration est un processus qui dure bien après l’obtention du statut de résident permanent. Comme il ne faut pas confondre les impressions obtenues pendant des vacances et la (parfois dure) réalité du quotidien, il faut aussi une bonne dose d’empirisme avant de faire des généralisations. Et pour ça, l’immigration ne doit pas s’arrêter aux premières impressions.




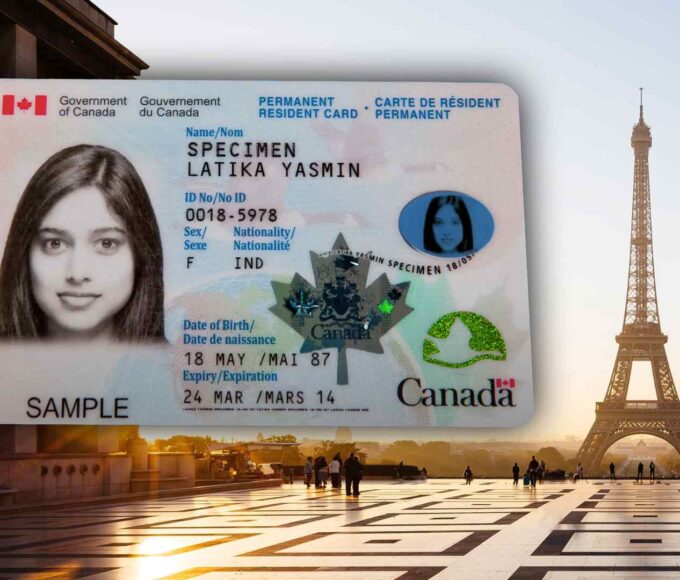
























Leave a comment