Pseudonyme : O’Hana
Statut : immigrant reçu au Canada
Date de naissance : 21 mars 1999
J’ai donc 7 ans. Même si n’importe quel document dit officiel vous dira que j’ai plutôt 31 ans. Cet âge-là correspond à celui de ma venue en ce monde. Mais mon âge de ma vie actuelle, soit celle d’immigrant, c’est sept ans et des poussières. En fait, ce n’est ni faux ni vrai que d’affirmer avoir ou 7 ans ou 31 ans. Cela dépend dans quelle perspective on se place. Car l’immigration vient changer tellement de choses. En premier lieu notre rapport au temps.
INSCRIVEZ-VOUS!

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.
Quand il s’agit de temps dans l’immigration, on pense le plus souvent aux délais dans le processus d’obtention du visa (j’adresse une pensée d’encouragement à tous les attentistes). Ça prend du temps car ce n’est jamais assez rapide. Et donc toujours trop long. Pourtant, pour nos proches, l’obtention du fameux sésame arrive toujours trop vite au contraire. Albert Einstein avait en substance ces mots simples pour expliquer sa théorie de la relativité générale : « une heure avec la personne aimée nous semblera quelques secondes. Quelques secondes avec la main sur un four allumé nous semblera une heure. C’est ça la relativité générale du temps. ». Un peu une histoire de temps psychologique où sa vitesse d’écoulement dépend de ce que vit la personne en comparaison du temps physique qui, lui, s’écoule invariablement à la même vitesse pour tout le monde. Et à mon sens, l’immigration c’est beaucoup de psychologie et un peu d’argent et de paperasseries, même si on peut penser le contraire quand on est en plein dedans.
Le temps est donc un facteur important dans un processus d’immigration. Souvent on le maudit, parfois on le sent filer entre les doigts. Ça va dépendre de chacun. Cela peut aussi dépendre de là où on est rendu dans notre immigration. Ainsi, il peut y avoir plusieurs temps. À date, j’en distingue trois :
Il y a le temps avant l’immigration.
Celui après l’immigration.
Et il y a un troisième temps, celui qui combine les deux précédents.
On a besoin de s’assurer d’avoir un temps pour tout (études, famille, affective, sociale, associative, pour soi). Ça structure, ça organise, ça permet de savoir où on s’en va avec ses skis. Bref, ça rassure. Mais quand tout va trop vite, étonnamment, on peut alors apprécier d’avoir un temps pour rien. Vraiment rien, juste du temps à gaspiller alors qu’on aura passé beaucoup de temps à en économiser ou en rentabiliser. Il est d’ailleurs ironique de constater combien il est socialement correct d’avoir du temps à gaspiller (loisir) quand on a, au préalable, passé beaucoup de temps à en rentabiliser (travail). Autrement dit, pour en dépenser, faut que j’en achète du temps d’abord. Et dans des sociétés où le temps est très structuré, il en vient à définir là où nous devrions être rendus à différentes périodes de nos vies. Ça, ça veut dire que le temps joue un puissant rôle social dans la construction de notre identité. Par exemple, si à mes 18 ans j’avais présenté ma blonde de l’époque comme sa future belle-fille à ma chère maman, je pense qu’elle ne l’aurait pas trouvé drôle (la situation, pas sa belle-fille). Peut-être que vous allez un peu trop vite, m’aurait-elle murmuré à mon oreille alors toute candide. Mais depuis quelques années, elle me fait souvent penser à un général présidant un conseil de guerre dont l’unique mission est de trouver ma future épouse parce qu’à 31-ans-ça-n’a-pas-de-bon-sang-de-ne-pas-être-encore-marié.
Ainsi, dans l’immigration, c’est un peu la même affaire. Comme le temps est censé nous dire là où on devrait être rendus, immigrer, c’est mettre tout ça aux vidanges. Et assumer ce que cela implique. Ainsi, pas évident de repartir à zéro lorsqu’on a 45 ans et qu’on est « censés » avoir à cet âge-là une situation professionnelle stable et ne plus avoir à prouver ce dont on est capable. Pas évident à 35 ans d’apprendre une nouvelle langue pour apprendre à vivre dans sa nouvelle société alors que cet apprentissage est censé être chose maîtrisée et réglée depuis belle lurette. Et pas évident à 30 ans de refaire son réseau social alors que, bien souvent, à cet âge-là, le tri entre les amitiés solides et celles superficielles a déjà été effectué (en tout cas, dans mon cas, c’est le cas).
L’immigration remet tous les compteurs à zéro : une sorte de Big Bang à l’échelle humaine, catégorie immigration. Certains verront cela comme un avantage (notamment ceux qui fuient quelque chose ou qui sont recherchés par Interpol), d’autres plutôt un inconvénient (dans ce cas-là, excusez ma naïveté : pourquoi immigrer alors ?).
Le temps avant l’immigration, c’est celui que connaissent notre famille et nos amis qui sont restés dans notre pays d’origine. Il est fait de genoux ensanglantés de l’enfance, des repas de famille, de la première beuverie, de dessins animés, etc. Quand on immigre, c’est comme si l’image qu’ils ont de nous dans leurs têtes se met sur « pause » : elle se fige, c’est le souvenir qu’ils gardent de nous. C’est intéressant dans la mesure où ça nous permet, à nous immigrants, d’avoir à notre disposition une source stable de référence sur soi-même. La partie moins intéressante est que lorsqu’on rentre au pays, soyez assurés que famille et amis se chargent de vous remettre illico presto dans l’image qu’ils ont gardé de vous. J’ai vécu cette situation lorsque je suis rentré dans mon lieu de naissance après six ans d’absence : six années à me débrouiller et à me définir par moi-même qui se sont envolés comme feuilles au vent à la seconde où j’ai posé mon pied dans la demeure familiale. Je suis alors redevenu le frère, le fils, l’oncle, etc avec tout ce que cela signifiait.
Comme si on m’avait remis sur le dos un vieil habit. Ce qui est bien avec un vieux vêtement, c’est qu’à force de le porter, il a pris le pli de notre corps, sa démarche, ses manies, sa façon d’être. Il s’est moulé à nous, comme une seconde peau. Il est confortable et c’est toujours agréable de le remettre de temps en temps. Un peu comme enfiler un vieux coton ouaté un dimanche pluvieux à lire un savoureux Amélie Nothomb, bien calé dans son divan. L’inconvénient c’est que si on a fini par le reléguer dans la catégorie « vieux vêtement », c’est parce qu’il se trouve dans le no man’s land obscur du royaume du garde-robe : trop vieux pour faire encore partie des choses présentables mais pas assez ringard pour s’en débarrasser (ou trop chargé sentimentalement encore). C’est le lien que je fais avec ma vie d’avant immigration : ce temps que j’aime retrouver de temps en temps mais, de temps en temps seulement (justement). Un peu comme la visite, quoi. L’affaire est que si je prends toujours mon cas ma famille a gardé une image de moi datant de 97, l’année où je suis parti. À ce moment-là, il s’est passé quelque chose de fascinant en eux à mon sujet : le dossier O’Hana a été archivé dans leurs esprits (tiroir de la Famille, étagère du Petit Frère, dernière mise à jour : août 97). Un dossier qu’ils ont ressorti six ans plus tard, un peu poussiéreux. Concrètement, untel me ressort un trait de caractère qui a bien évolué depuis « alors, toujours aussi impatient ? » – untel me parle d’un souvenir lointain pour moi, encore vivace pour elle « tu sais la fois où on est allés manger dans ce resto ». Ce n’est pas désagréable, ça rassure même. Dans le tourbillon de l’immigration où on change de vie, où on se déconstruit des repères pour s’en refaire d’autres, où le choc culturel peut transformer sa propre façon de se voir, un vieux vêtement rappelle des émotions, nous arrache une larme de souvenir, fait émerger des racines affectives, bref, constitue une ancre stabilisatrice. Comme si on nous disait : « tu n’as pas changé ! » ou « ha là, je te reconnais bien ». C’est humain. Après tant d’années, pouvoir recaser l’autre dans le tiroir et l’étagère où on l’avait laissé, ça rassure. Et nous, ça nous permet de mesurer le chemin parcouru hors soi et surtout en soi. Ce qui n’est pas si mal après tout.
Le temps après l’immigration, c’est celui sur lequel nous avons un peu plus de pouvoir car si on ne choisit pas son lieu de naissance, on peut cependant choisir son lieu d’immigration (et donc, ce qui va avec : le style de vie, l’environnement, les gens, etc). Ce temps-là, c’est donc nous dans son essentialité qui le façonnons mais nous sommes aussi influencés par ceux que nous allons côtoyer (futurs collègues de travail, voisinage, etc). Et pour eux, c’est le mode « Lecture » : littéralement, on naît dans leurs vies. La seconde d’avant, on n’existait pas. La seconde d’après, on est là, devant eux, valises dans les mains et soif de découvrir notre nouveau pays dans la coeur.
Rationnellement, ce monde-là sait qu’on a eu une vie avant d’immigrer. Mais sur le plan affectif, on n’est pas plus différent qu’un nouveau-né finalement. Une analogie appropriée en ce sens qu’on ne connaît pas grand chose des us et coutumes de notre pays d’accueil. D’autant plus qu’ils ne peuvent pas nous rattacher à une famille, un cercle d’amis ou une région de leur bout de pays, vous savez tous ces petits détails insignifiants en soi mais qui mis ensemble, donnent quelque chose de consistant. Genre, une identité. De celle qui permet de caser une personne dans une structure qu’on connaît. Car nous sommes justement des immigrants, i.e. venant d’un ailleurs qui ne fait pas partie de leur quotidien ! Et un quotidien, c’est par exemple, pouvoir leur dire : « non, vendredi soir, je ne peux pas désolé : je soupe chez mes parents » ou « je vais luncher chez ma s’ur aujourd’hui car ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vus » ou encore « ça te tentes-tu de venir prendre un verre ce soir avec mon meilleur chum et moi, mon ami depuis mon enfance ! ». On ne peut pas dire cela à notre entourage québécois, car papa/maman, s’ur et ami ne sont pas ici avec nous. Tout cela, ça fait partie de notre ancienne vie, enfin, pas exactement ancienne, mais plutôt celle de « l’autre côté », là-bas « dans ton pays d’origine » dont on leur donne des échos parfois (quand on y rentre ou revient de vacances par exemple). Avec le temps, se crée alors une sorte de dédoublement : ils savent très bien que je suis « ça » parce qu’ils le savent en me côtoyant (ex : une personne qui aime les soupers entre amis) mais ils savent également « ceci » qui est beaucoup moins évident à saisir car c’est moi qui leur ai dit (ex : une personne qui aime les balades en mer).
Il y a quelques semaines, les parents d’un ami immigrant français installé à Montréal, sont venus pour la première fois lui rendre visite au Québec. Des amis québécois – qui connaissent bien maintenant mon ami et qui ont rencontré ses parents – m’ont exprimé leur sentiment de pouvoir enfin mettre de la « chair » parentale/familiale autour de ce qu’ils connaissaient de la vie de mon ami. Comme si, tout à coup, ils réalisaient que c’est vrai finalement que l’ami immigrant avait aussi des parents ! Quand ma soeur est venue me voir ici il y a quatre ans, ce fût le télescopage de deux temps de ma vie : celle d’avant et celle d’après mon immigration. Expérience fascinante. Autant ma soeur me rappelait combien j’avais changé, autant mes amis québécois étaient ravis de connaître certains exploits peu glorieux de mon adolescence dont je n’avais bizarrement plus souvenir. Sourire gêné de votre serviteur et doux sourire revanchard de ma tendre s’ur. La vengeance est un plat qui se mange froid m’a-t-elle alors dit. Ce qui prend drôlement du sens vu l’hiver qu’on a au Québec ai-je continué en riant !
Et il y a ce troisième temps, celui qui nous invite à combiner les deux précédents. Probablement le plus complexe des trois, et par conséquent, potentiellement le plus enrichissant de tous. Car il cherche à harmoniser un passé avec un présent pour construire un futur commun pour tous ces temps. L’éternel dilemme cornélien entre ne jamais oublier d’où l’on vient et se rappeler où l’on vit maintenant. Dans leur mythologie, les Grecs avaient deux façons d’appréhender le temps. Il y avait d’abord Chronos qui personnifiait en quelque sorte le temps linéaire, structuré et organisé. C’est lui qui me permet de dire que 2005 est l’année passée ou de planifier un rendez-vous la semaine prochaine dans mon agenda. Et il y avait Kaïros qui était souvent représenté sur la pointe des pieds comme s’il était toujours sur le point de partir pour souligner ce temps d’opportunité, imprévu, fait d’occasions qu’il faut saisir maintenant ou jamais. Peut-être est-ce cela aussi ce troisième temps : ce Kaïros facétieux qui nous invite à saisir l’instant présent maintenant que nous savons vivre avec deux temps en nous.




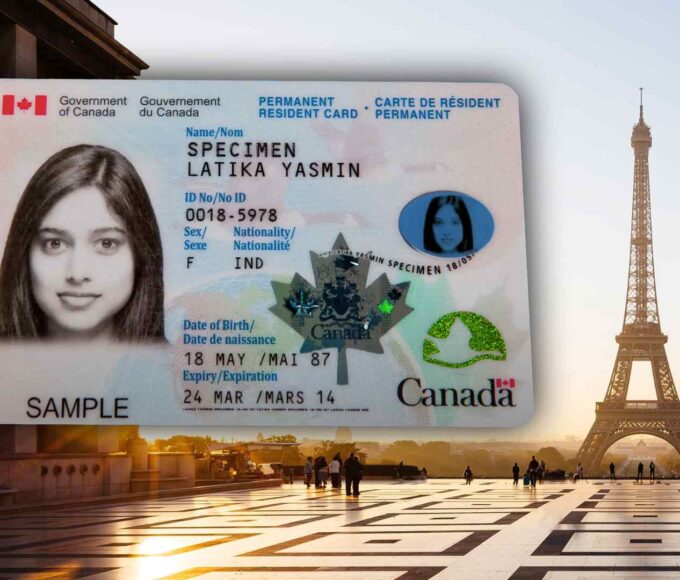
























Leave a comment